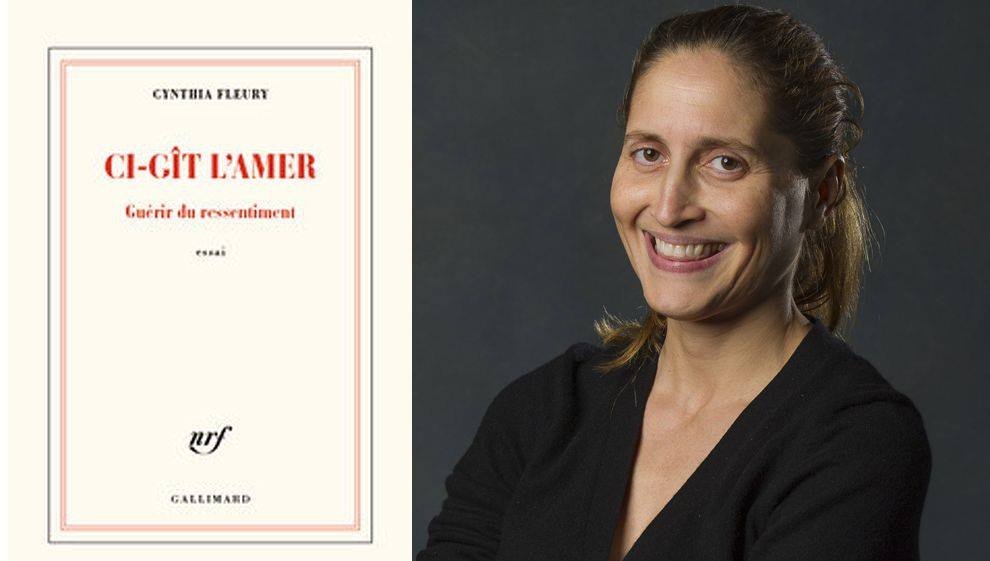
Le problème du ressentiment : Cynthia Fleury psychanalyse l’amertume (2ème partie)
I. Amertume : le vécu de l’homme du ressentiment
La rumination
En amont de la Première Guerre mondiale, Max Scheler, en 1912, a défini avec une grande clarté le ressentiment dans son essai L’Homme du ressentiment. Dans un temps terrible et traversé par des pulsions mortifères, écrit Scheler, n’importe quel être humain pourrait être exposé à l’expérience de la rumination d’une haine, souvent infondée, dirigée contre un autre : « L’expérience et la rumination d’une certaine réaction affective dirigée contre un autre, qui donnent à ce sentiment de gagner en profondeur et de pénétrer peu à peu au cœur même de la personne, tout en abandonnant le terrain de l’expression et de l’activité.[1]».
Comprendre la dynamique du ressentiment ne va pas sans prendre en compte un terme clé : la rumination. La rumination, précise Cynthia Fleury, est quelque chose qui se mâche et se remâche, engendrant ainsi cette amertume caractéristique d’un aliment fatigué par la mastication. La rumination implique donc la monotonie qui provoque la lassitude. Si la rumination est monotone, elle ne peut être que la rumination d’une autre rumination, c’est-à-dire celle qui consiste, d’emblée, à revivre une « ré-action » émotionnelle qui, à l’origine, pouvait être adressée à quelqu’un en particulier. Mais en s’exacerbant, l’indétermination de l’adresse du ressentiment ira crescendo. La détestation se déplacera du personnel au global. Plusieurs individus, non concernés initialement par la réaction affective, pourront être frappés et attrapés par l’extension du phénomène. Le double mouvement qui s’opère ici, écrit Cynthia Fleury, n’est pas sans ressemblance avec celui que décrit Karl Polayni dans La Grande Transformation (1944) :
Plus le ressentiment gagne en profondeur, plus la personne est impactée en son sein, en son cœur, moins sa capacité d’agir se maintient, et la créativité de son expression s’affaiblit. Cela ronge. Cela creuse. Et la compensation devient, à chaque relance dudit ressentiment, plus impossible, le besoin de réparation étant à ce point inassouvissable. Le ressentiment nous mène vers ce chemin, sans doute illusoire, mais néanmoins bien âpre, de l’impossible réparation, voire de rejet. Il est évident qu’il y a des réparations impossibles et qui obligent à l’invention, à la création, à la sublimation[2].
La sphère du ressentiment est donc celle de la morsure acérée qui, au même temps, empêche la projection lumineuse et valide une certaine forme de jouissance de l’obscur, par retournement, par stigmatisation inversée aussi. Scheler qualifie cette rumination de reviviscence continuelle du sentiment, de « reviviscence de l’émotion même, un re-sentiment[3]».
La morsure du ressentiment cause une blessure, une plaie. C’est une brèche non colmatée qui rendra plus tard la blessure plus douloureuse, la béance plus active, parfois aiguë et souvent chronique. Cette douleur chronique alimente le ressentiment et interrompt le travail de l’intellect, l’aide de la raison. Les coups de ces émotions tristes confinent à la jalousie, à l’envie, au mépris de l’autre et finalement de soi. Le sentiment d’injustice est la matrice de la volonté de vengeance. Scheler utilise le terme allemand Groll pour qualifier cette exaspération :
Le mot allemand qui conviendrait le mieux serait le mot Groll, qui indique bien cette exaspération obscure, grondante, contenue, indépendante de l’activité du moi, qui engendre petit à petit une longue rumination de haine et d’animosité sans hostilité bien déterminée, mais grosse d’une infinité d’intentions hostiles[4].
Quand Nietzsche parle dans sa Généalogie de la morale d’ « intoxication » par « la morale des esclaves », Scheler parle d’ « auto-empoisonnement[5]». L’auto-empoisonnement, c’est la rancœur ; et la rancœur, selon Cynthia Fleury, c’est le fait d’en vouloir à : si une personne succombe aux morsures du ressentiment, l’en vouloir à prend la place de la volonté et va agir comme une énergie mauvaise se substituant à l’énergie vitale joyeuse. Cynthia Fleury qualifie cette substitution de falsification de la volonté, d’empêchement de la bonne volonté, de privation de la volonté pour. Tout est contaminé. Le sujet devient « gros » et perd son agilité, sa capacité au mouvement.
Scheler ajoute que les malfaits de l’auto-empoisonnement provoquent une déformation du sens des valeurs, comme aussi de la faculté du jugement. Les répercussions du ressentiment attaquent donc le sens du jugement. Ce dernier est rongé de l’intérieur, troué ; la « vermine » est là. Dès lors, la faculté de jugement, qui est l’unique voie rédemptrice face au ressentiment, se met au service du maintien de ce dernier et n’œuvre aucunement à sa destruction. C’est là où réside, écrit Cynthia Fleur, l’aspect le plus vicié du phénomène : utiliser la faculté de juger – l’instrument possible de libération – pour pérenniser la servitude et l’aliénation. La pulsion mortifère ne peut se passer de la servitude.
L’individuation
L’individu échappe au ressentiment dans la mesure où il sera capable de faire appel à sa créativité, à sa puissance d’innovation : il se fait de plus en plus le narrateur de soi en délivrant un récit ou une biographie. L’individu peut donc se soustraire à l’aliénation en disant je suis libre, je suis égal à tout autre.
Comme Cornelius Castoriadis, philosophe et psychanalyste, Cynthia Fleury soutient l’idée d’une différence radicale entre les hommes dans leur aptitude ou non à se tenir à distance de leur propre ressentiment. Le destin des hommes se sépare ici entre ceux qui reconnaissent leur propre ressentiment et s’en tiennent à distance, et ceux qui, comme les premiers, le reconnaissent et deviennent le lieu de sa fossilisation. Dans Extraits choisis[6], Castoriadis pose la question du but de la cure psychanalytique : « Que peut-on vise dans la psychanalyse d’un individu ? » Sa réponse fut la suivante : « Non pas, certes, de supprimer ce fond obscur, mon inconscient ou son inconscient – entreprise qui, si elle n’était pas impossible, serait meurtrière ; mais d’instaurer un autre rapport entre inconscient et conscient.[7]». Envisager un autre rapport entre le conscient et l’inconscient nécessite l’établissement d’une relation créatrice et sereine entre conscience et inconscience. C’est à travers l’établissement d’une telle relation que va surgir l’individuation d’un être, sa subjectivation. Ce que Wilhelm Reich appelle dans ses écrits « l’aptitude à la liberté ».
Bien que la vérité de l’analyse soit déterminante pour un sujet, Castoriadis rappelle aussi son importance pour la société dans laquelle ce sujet vit :
Toute la question est de savoir si l’individu a pu, par un heureux hasard ou par le type de société dans lequel il vivait, établir un tel rapport, ou s’il a pu modifier ce rapport de manière à ne pas prendre ses phantasmes pour la réalité, être tant que faire se peut lucide sur son propre désir, s’accepter comme mortel, chercher le vrai même s’il doit lui en coûter, etc. Contrairement à l’imposture prévalant actuellement, j’affirme depuis longtemps qu’il y a une différence qualitative, et non seulement de degré, entre un individu ainsi défini, et un individu psychotique ou si lourdement névrosé que l’on peut le qualifier d’aliéné, non pas au sens sociologique général, mais au sens précisément qu’il se trouve exproprié « par » lui-même « de » lui-même. Ou bien la psychanalyse est une escroquerie, ou bien elle vise précisément cette fin, une telle modification de ce rapport[8].
Le but de la psychanalyse serait donc d’aider l’individu à sortir de lui-même par lui-même en encourageant son « aptitude à la liberté ». La différence qualitative entre un individu ainsi défini et un aliéné par le ressentiment serait dans le passage à l’acte créateur et régénérateur qui empêche la fossilisation du ressentiment. « Il y va de l’avènement d’un homme qualitativement différent de ses congénères, un homme qui détiendrait une clé de l’humanisme et de la civilisation afférente[9]».
Nul homme, dans l’aliénation vécue dans et par le ressentiment, ne peut échapper au processus de réification. Dans L’institution imaginaire de la société, Castoriadis dresse le pitoyable tableau de la dynamique de chosification qui organise la société comme les relations intimes : celles-ci étant indissociables des conflits pulsionnels siégeant dans les individus[10]. Celui pour qui les autres sont des choses, écrit Castoriadis, est lui-même une chose. C’est l’individu aliéné. Par contre, l’individu en voie de désaliénation et de régénération rétorquera au processus de réification en disant : « Je ne veux pas que les autres soient choses, je ne saurais pas quoi en faire ». Et c’est là où réside le projet politique et social de la psychanalyse, celui de « ne pas considérer autrui et soi-même comme une chose parce que, dès lors, le mécanisme collectif de ressentiment se consolidera et les hommes et les sociétés scinderont leur destin selon ce biais ressentimiste, rendant presque impossible la désaliénation psychique et sociale.[11]»
Universelle amertume
Ne croyant plus aux territoires essentialisés, mais aux territoires dialectisés, Cynthia Fleury situe l’origine de l’amertume, qui mène souvent au ressentiment, dans le territoire de l’enfance où se crée un nouage inextricable entre « l’amer, la mère, la mer ». Dès l’enfance, ajoute Cynthia Fleury, se joue quelque chose d’important avec l’amer et ce « Réel » qui explose notre monde serein. « Ci-gît la mère, ci-gît la mer[12]». La séparation avec les parents, c’est aussi de l’amertume : d’un côté, elle incombe de devenir soi-même, de l’autre côté, elle nécessite la concrétisation de la transmission de l’éducation parentale.
Aucune terre n’est éternellement maudite, les individus aussi. Aucun d’entre eux n’est éternellement maudit, nullement condamné à vivre dans l’amertume du ressentiment. L’amer, il faut l’enterrer et fructifier dessus autre chose. « Amère fécondité qui vient fonder la compréhension à venir[13]». Qu’est-ce qui est à venir ? Prendre le large, par exemple.
Lorsque Herman Melville, l’une des figures de proue de la littérature américaine, fait parler Ishmael dans Moby Dick (1851), texte consacré à la quête inlassable de la baleine blanche, c’est par ces mots qu’il décrit le malaise existentiel qui l’étreint et surtout, la ressource existentielle à laquelle il aspire :
Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, quand mon âme est un bruineux et dégoulinant novembre, quand je me surprends arrêté devant une boutique de pompes funèbres ou suivant chaque enterrement que je rencontre, et surtout lorsque mon cafard prend tellement le dessus que je dois me tenir à quatre pour ne pas, délibérément, descendre dans la rue pour y envoyer dinguer les chapeaux des, je comprends alors qu’il est grand temps de prendre le large[14].
Prendre le large pour ne pas faire « dinguer » les chapeaux des passants, pour ne pas faire rugir ce ressentiment qui monte. C’est en effet l’aspiration d’Ishmael à naviguer dans le large existentiel, afin de pouvoir sublimer sa finitude et palier à sa lassitude. Si le sujet n’a pas de réponse à la lassitude qui lui tombe dessus, et comme il n’y a pas de réponse a priori, il ne lui reste, après coup, que de naviguer, traverser, aller vers l’horizon, trouver un ailleurs pour être de nouveau capable de vivre, de revivre.
Contre les ténèbres intérieures et dangereuses de l’amertume, contre sa cristallisation définitive qui débouche sur le ressentiment, Ishmael sait donc pertinemment que le besoin d’Océan vient pallier pour chaque homme le sentiment de solitude, le « sentiment abandonique inaugural ». Au lieu de chercher du sens du côté de l’origine ou du côté de l’avenir, le besoin d’Océan offre une troisième voie pour Ishmael et pour tous ceux qui éprouvent de l’amertume : celle du désir d’immensité et du suspens que peut représenter l’eau, la mer, l’Océan. Melville écrit encore dans Moby Dick « revoir le monde de l’eau ».
Sur le sentiment océanique, Cynthia Fleury précise que ce dernier a été défini par Romain Rolland dans la correspondance qu’il entretint avec Freud, en 1927, afin de décrire ce désir « universel » de faire « un » avec l’univers. L’océanique témoigne chez Romain Rolland d’une spiritualité spontanée de l’homme et indépendante de celui-ci, située à un en-deçà du sentiment religieux. Une métaphysique de la mer ? Peut-être ! Et Cynthia Fleury ajoute ceci : « L’océanique se dialectise avec l’abandonnique inaugural, permettant au sujet de ne pas se ressentir ‘’manquant’’, d’affronter la séparation et la finitude (ci-gît la mère) sans céder à la mélancolie. Il relève d’un sentiment d’éternité, de fulgurance et de repos.[15]» En 1929, Freud revient longuement sur le sentiment océanique du Moi dans l’ouverture de Malaise dans la civilisation. L’océanique est l’antithèse de la non-issue ressentimiste.
Idée régulatrice
Le ressentiment possède une aptitude dans laquelle il excelle le plus : aigrir, aigrir la personnalité, aigrir la situation, aigrir le regard sur, explique Scheler dans L’Homme du ressentiment. « Le ressentiment empêche l’ouverture, il ferme, il forclôt, pas de sortie possible.[16]» Cynthia Fleury fait remarquer que dans certaines psychoses tenaces, le patient met toute son énergie à empêcher la guérison, à faire faillir le travail du médecin et de la médecine : son refus de la guérison produit une « non-issue ».
Vouloir la « non-issue », c’est vouloir la non-action. C’est aussi suspendre le temps pour mieux haïr, se haïr aussi, plus durablement. Le ressentiment ne relève pas seulement la non-action, il relève aussi de la rumination, du choix de ruminer dans la non-issue. De ce fait, on peut placer le ressentiment entre l’ « impuissance à » (non-action) et l’acquiescement à l’option de l’ « impuissance à » (rumination).
Dans son parachèvement, le ressentiment ronge l’intériorité de la personne, déstabilisant ainsi son maintien identitaire. L’impuissance du sujet tourne rapidement vers un malaise ontologique, extrêmement dévastateurs. Scheler écrit à ce sujet : « je puis tout te pardonner ; sauf d’être ce que tu es ; sauf que je ne suis pas ce que tu es ; sauf que je ne suis pas toi. Cette envie porte sur l’existence même de l’autre ; existence qui comme telle, nous étouffe, et nous est un reproche intolérable[17]».
Personne ne peut s’illusionner sur l’apaisement possible, dans le confort victimaire, d’un sujet rongé par la haine de l’autre, nourrie par une fantasmatique débordante. Or pour sortir d’une telle situation, extrêmement compliquée, Cynthia Fleury propose de « poser comme idée régulatrice que la guérison est possible mais que la clinique est sans doute insuffisante dans son soin, dans la propagation continue de son soin. Le thérapeute est humain : il faut compter aussi avec cette insuffisance structurelle de la cure.[18]» A côté de la technique et du savoir médicale, thérapeutique et scientifique, la volonté du sujet reste déterminante dans l’aboutissement de la cure. Sans la volonté du sujet, il est impossible de dépasser le ressentiment. Pourquoi cette volonté est manquante ? Précisément, cette dernière est enterrée par le sujet lui-même qui, pour éviter de faire face à sa responsabilité, à son obligation morale d’autodépassement, préfère la mécanique de la rumination, de la réitération de la plainte, de la non-perception.
Le choix de la non-perception ne signifie pas déni de la réalité mais, au contraire, la fétichisation de celle-ci. A quoi sert le « fétiche[19] », se demande Cynthia Fleury ? Contrairement « à remplacer la réalité qui est insupportable au sujet. Autrement dit, si le sujet a tant de difficulté à se dessaisir de la plainte, c’est parce que celle-ci fonctionne comme un « fétiche », elle lui procure le même plaisir, elle fait écran, elle permet de supporter la réalité, de la médier, de dé-réaliser.[20]» Le ressentiment maintien, de manière chronique, la jouissance dans une mémoire blessée, sur le modèle d’un éternel châtiment. Le ressentiment-fétiche agit comme une obsession.
La possibilité de guérison de l’homme ressentimiste, du sujet et du patient est un parti pris : une idée régulatrice. Comme l’Idée régulatrice de Kant dans la Critique de la raison pure (1781) qui, entre autres, dirige l’entendement vers un but et régule l’unité systématique du divers de la connaissance empirique, l’idée régulatrice de Cynthia Fleury pose le pari que l’homme est capable : il n’est pas réductible à un patient, il est aussi agent. Prendre le large pour sublimer le ressentiment, prendre conscience du déni qui nous ronge de l’intérieur : cela s’appelle réguler l’amertume pour mieux l’éradiquer. « Quel est le sceau de l’acquisition de la liberté ?, [s’interrogea Nietzsche], – Ne plus avoir honte de soi-même.[21]»
[1] .Max Scheler, L’Homme du ressentiment (1912), Gallimard, 1933, p. 9, dans Cynthia Fleury, Ci-gît l’amer, Paris, Gallimard, 2020, p. 18. A propos de l’antisémitisme de Scheler, Cynthia Fleury précise : Les thèses de Scheler sont citées sans cautionner ceux de ses propos qui ont pu faire le lit d’un antisémitisme très caractéristique des années 1930 et perpétuellement blâmable.
[2] .Cynthia Fleury, Ibid., p. 19.
[3] .Max Scheler, op.cit., p. 9.
[4] .Ibid.
[5] .Ibid., p. 14.
[6] .Cornelius Castoriadis, Extraits choisis, par quentin@no-log.org, dans Cynthia Fleury, op.cit., p. 16.
[7] .Cornelius Castoriadis, Ibid., p. 33.
[8] .Cornelius Castoriadis, op.cit., p. 34.
[9] .Cynthia Fleury, op.cit., p. 17.
[10] .Voir sur ce sujet : « Racines subjectives et logique du projet révolutionnaire », dans L’institution imaginaire de la société, Seuil, 1975, p. 135-141.
[11] .Cynthia Fleury, Ibid., p. 18.
[12] .Ibid., p. 13.
[13] .Cynthia Fleury, op.cit., p. 14.
[14] .Herman Melville, Moby Dick (1851), Paris, Gallimard, « Folio », 1980, p. 41.
[15] .Cynthia Fleury, op.cit., p. 15.
[16] .Ibid., p. 24.
[17] .Max Scheler, op.cit., p. 25.
[18] .Cynthia Fleury, op.cit., p. 25.
[19] .S. Freud, Le fétichisme, 1927.
[20] .Cynthia Fleury, Ibid., p. 27.
[21] .Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, trad. Patrick Wotling, Paris, G. Flammarion, 1997, p. 224.
